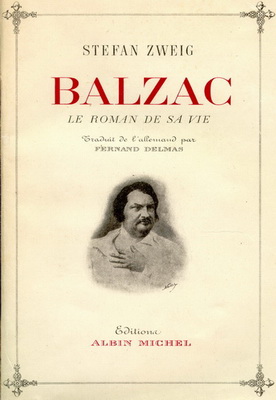Stefan ZWEIG

Né à Vienne le 28 novembre 1881
Décédé à Petrópolis, Brésil le 22 février 1942
« J'ai personnellement plus de plaisir à comprendre les hommes qu'à les juger »
Stefan Zweig
Grand représentant de la littérature autrichienne, Stefan Zweig incarne le bouillonnement de la vie culturelle viennoise de l'entre-deux-guerres. Proche de Sigmund Freud, de Rainer Maria Rike ou encore d'Émile, Zweig est docteur en philosophie, traducteur, poète et romancier.
Principalement connu pour ses nouvelles, telles que «Amok» ou «Vingt-quatre heures de la vie d'une femme», l'auteur excelle dans l'art de la biographie. Parmi les nombreuses biographies dont il est l'auteur, celles de Marie Stuart de Marie-Antoibette, de Balzac ou encore celle d'Érasme, qui s'apparente à une autobiographie masquée, témoignent de la finesse de ses analyses psychologique et historique.
Pacifiste convaincu, Zweig n'a de cesse d'écrire contre la guerre, notamment pendant et après la Première Guerre mondiale dans des oeuvres comme «Jérémie» ou «Ivresse de la métamorphose». C'est donc avec désespoir qu'il perçoit la montée du nazisme et la menace d'un nouveau conflit à la fin des années 1930.
En 1941, l'auteur du «joueur d'échecs» fuit l'Europe pour le Brésil où il se donne la mort avec son épouse. Jusqu'au bout, Stefan Zweig aura cherché à «exalter la vie», pour «en saisir le drame de façon plus claire et plus intelligible» dans une oeuvre profonde et lumineuse qui fait de lui l'un des plus grand écrivain du XXe siècle.
Balzac - Le roman de sa vie (Publication posthume en 1946) - Le Livre de Poche 03/1996
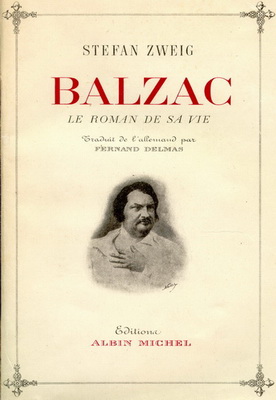
[... Chapitre VII – L’homme de trente ans
A peu près à la même époque ou se noue cette liaison passagère avec la duchesse d'Abrantès, entre dans la vie du romancier une autre femme, Zulma Carraud, la meilleure, la plus précieuse, la plus noble, la plus pure et en dépit de tout l'éloignement dans le temps et dans l'espace, la plus durable de ses amitiés. Du même âge que Laure, la sœur préférée de Balzac, Zulma Tourangin épousa en 1816 le capitaine d'artillerie Carraud, un homme «d'une stricte loyauté», dont le profond mérite, par suite d'une malchance particulière, ne fut pas apprécié. Pendant la période napoléonienne, tandis que ses camarades profitent sur les champs de bataille et dans les ministères des circonstances heureuses de la guerre et font des carrières fantastiques, ce probe et vaillant soldat a le malheur d'être retenu prisonnier sur les pontons anglais. Quand enfin il profite d'un échange, il est trop tard. Nulle part on ne peut trouver un emploi convenable à ce petit officier qui n'a eu en captivité aucune occasion de se faire des relations précieuses ou de gagner des décorations de guerre. On l'enterre d'abord dans de petites garnisons de province et finalement on en fait un directeur de la poudrerie nationale. La famille Carraud mène ainsi dans l'ombre une vie tranquille et étriquée. Zulma Carraud, qui n'est pas très jolie, et boite légèrement, a, sans l'aimer profondément, le plus grand respect pour le caractère plein de dignité de son mari et la plus grande pitié pour la mauvaise fortune qui a de bonne heure brisé ses ambitions et sa joie de vivre. Elle partage fidèlement ses soins entre lui et son fils, et comme c'est une femme supérieurement intelligente et qu'elle possède un tact du cœur vraiment génial, elle trouve le moyen de réunir autour d'elle, même dans un trou perdu, un cercle de gens honnêtes, dignes, sans être vraiment distingués et parmi eux un capitaine Périolas pour qui, par la suite, Balzac aura une particulière amitié et à qui il doit de précieux renseignements pour ses œuvres militaires.
La rencontre de Zulma avec Balzac dans la maison de sa sœur constitue pour tous deux un hasard particulièrement heureux. Pour cette femme cultivée aux idées généreuses, dont le niveau intellectuel est très au-dessus de son entourage et même au-dessus de celui des célèbres confrères et critiques de Balzac, — c'est un événement dans sa vie étroite, de rencontrer un homme dont elle aperçoit aussi vite le génie poétique que les qualités rayonnantes et généreuses du cœur. Pour Balzac, de son côté, c'est une chance de connaître une maison où il puisse se réfugier quand il est épuisé par son travail, pourchassé par ses créanciers, écœuré par ses affaires d'argent, sans être porté aux nues par l'admiration des snobs ou donné en spectacle par des vaniteux. Toujours une chambre est préparée pour lui où il peut travailler tranquillement et, le soir, des gens de cœur l'attendent, de bons esprits avec lesquels il peut librement bavarder et goûter les joies d'une complète intimité. Ici il peut pour ainsi dire se montrer en bras de chemise, sans craindre d'être à charge à quelqu'un, et le sentiment d'avoir toujours un refuge à sa disposition pour les détentes si nécessaires après les périodes d'extrême tension le fait rêver des mois à l'avance de ces excursions vers les garnisons des Carraud, Saint-Cyr, Angoulême ou vers leur propriété de Frapesle.
Balzac ne tarde pas à se rendre compte de la valeur morale de cette femme tout à fait inconnue et sans prestige dont le génie secret est une surprenante faculté de faire don de soi-même dans la sincérité. Et alors commence une liaison qui ne se peut imaginer plus pure et plus belle. Il n'est pas douteux que Zulma Carraud ait aussi ressenti comme femme le charme unique en son genre de cette personnalité, mais elle retient son cœur d'une main sûre. Elle sait qu'aucune femme ne conviendrait autant qu'elle à cet esprit inquiet, une femme capable de «s'effacer» complètement devant cet être supérieur, et pourtant capable de le décharger discrètement de toutes les difficultés et de les écarter : «J'étais votre femme prédestinée», lui écrit-elle un jour, et lui de son côté : «Il me faudrait une femme comme vous, une femme désintéressée.» Il le reconnaît : «Un quart d'heure passé près de vous le soir vaut mieux que toutes les félicités d'une nuit près de cette belle.»

Mais Zulma Carraud est en même temps trop lucide pour ne pas savoir qu'elle est dépourvue d'attraits féminins et sensuels et ne peut ainsi satisfaire de façon durable un homme qu'elle met si haut au-dessus de tous, et surtout il est impossible à une telle nature de tromper ou d'abandonner un mari dont toute la vie repose sur la sienne. Elle met donc son point d'honneur à lui offrir une amitié, une bonne et sainte amitié, comme il dit, exempte de toute vanité, de toute ambition et de tout égoïsme : «Je ne veux pas qu'il entre un grain d'amour-propre dans notre liaison.»
Comme elle ne peut être à la fois pour lui un guide et une amante, comme l'avait été autrefois Mme de Berny, elle souhaite vivement voir séparées l'une de l'autre ces deux sphères pour n'en être que plus entièrement celle qui vient à son aide dans toutes ses misères et elle s'écrie : «Mon Dieu ! Pourquoi le sort ne m'a-t-il pas jetée dans cette ville qu'il vous faut habiter ? Moi, j'aurais été tout ce que vous auriez désiré comme affection... C'eût été le bonheur en deux tomes.» Mais comme il n'est nullement possible de diviser ainsi sa vie en deux sphères : celle des sens et celle de l'esprit, elle cherche en elle-même un expédient : «Je vous adopte comme mon fils.»
Elle veut donner pour tâche à sa vie de penser pour lui, de prendre soin de lui, de l'aider de ses conseils; comme toutes les femmes dans la vie de Balzac elle éprouve, elle aussi, le besoin d'offrir son amour sous une forme maternelle à ce génie enfantin qui ne sait pas organiser lui-même sa vie.
En fait Balzac n'a jamais trouvé - pas même parmi les critiques et les artistes les plus célèbres de son temps - un meilleur conseiller pour son art et sa vie que cette petite femme ignorée, enterrée au fond de sa province dans la banalité de sa vie familiale. En un temps où l'œuvre de Balzac a bien auprès du public un succès de mode, mais ne trouve pas encore la moindre compréhension (1833), elle écrit avec cet accent d'inébranlable honnêteté qui caractérise chacune de ses paroles : «Vous êtes le premier prosateur de l'époque et, pour moi, le premier écrivain. Vous seul vous êtes semblable et tout paraît fade après vous.»
Sans doute ajoute-t-elle tout de suite après : «Pourtant, très cher, j'ai quelques scrupules de joindre ma voix aux mille voix qui vous louent.»
Dans toutes les années qui se sont écoulées depuis lors on ne saurait trouver des jugements et des critiques plus fondés que les siens et aujourd'hui encore, après un siècle, tous les éloges, toutes les réserves de cette inconnue, femme d'un capitaine d'Angoulême, portent plus exactement sur l'essentiel que tous les jugements de Sainte-Beuve et de la critique professionnelle. Elle admire Louis Lambert, Le Colonel Chabert, César Birotteau et Eugénie Grandet, tandis qu'elle éprouve un vif sentiment de malaise devant les récits de salon parfumés de La Femme de trente Ans, reproche, avec grande raison au Médecin de campagne d'être «trop pâté et trop plein d'idées» et marque de la répugnance pour la pseudomystique prétentieuse de Séraphîta. Avec une lucidité surprenante elle perçoit toujours tous les dangers qui menacent son ascension. Quand il veut s'engager dans la politique, elle le met désespérément en garde : «Les Contes Drolatiques valent mieux qu'un ministère.»
Quand il s'oriente vers le parti royaliste elle lui crie : «Laissez la défense des personnes à la domesticité de la cour et ne salissez pas votre juste célébrité de pareilles solidarités.»
Elle proclame obstinément qu'elle gardera toujours sa tendresse à «la classe pauvre, tant calomniée, tant exploitée par les passions des riches... parce que je suis peuple, peuple aristocratisé, mais toujours sympathique à qui souffre l'oppression».
Elle le met en garde quand elle voit comme il gâte ses livres par la hâte avec laquelle il les bâcle : «Est-ce écrire», lui dit-elle, «que de le faire le couteau sous la gorge, et pouvez-vous parfaire une œuvre que vous avez à peine le temps d'écrire ?»
Et pourquoi cette hâte? Simplement pour s'assurer un luxe qui peut convenir à un boulanger enrichi, mais pas à un génie : «Celui qui a peint un Louis Lambert devrait peu avoir besoin de chevaux anglais ! Honoré, je souffre de ne pas vous voir grand ! ... Ah ! J'eusse vendu chevaux et voiture, la tenture perse même, plutôt que de donner à un drôle... le droit de dire, et il le dira : Pour de l'argent, on l'a toujours.»
Elle aime son génie, redoute ses faiblesses et le voit ainsi avec angoisse précipiter sa production, se laisser accaparer par les salons aristocratiques, s'entourer, pour en imposer à cette «bonne société» qu'elle méprise, d'un luxe inutile qui l'endette, et, dans sa prévoyance trop justifiée, elle l'adjure : «Ne vous usez donc pas avant le temps !»
Avec son goût français très exigeant pour la liberté, elle voudrait voir le plus grand artiste du siècle, indépendant dans tous les sens, indépendant de l'éloge et du blâme, du public et de l'argent et elle se désespère parce qu'il tombe toujours dans de nouvelles servitudes et de nouvelles dépendances. «Forçat, vous le serez toujours, votre vie décuple se consumera à désirer et votre sort est de tantaliser pendant toute sa durée.»
Paroles prophétiques !

En un temps où les duchesses, les princesses le flattent et l'encensent, c'est un témoignage de l'honnêteté profonde de Balzac - mille fois plus sage que ne le laisseraient croire ses petites vanités - d'avoir non seulement accepté ces reproches durs et souvent violents, mais encore d'avoir toujours remercié cette amie véritable de sa sincérité : «Vous êtes mon public», lui répond-il, «vous que je suis si fier de connaître, vous qui m'encouragez à me perfectionner.»
Car un très sûr instinct lui fait craindre, dans le succès de Balzac, la mode, la sensation. Justement parce qu'elle connaît son grand cœur, parce qu'elle aime ce «Balzac nativement bon et cordial derrière toutes ses mousselines, derrière tous ses cachemires et ses bronzes», elle craint - et non sans raison - que son succès de snob dans les salons et son succès matériel auprès des éditeurs ne deviennent un danger pour son talent et pour son caractère. Son ambition, c'est que ce génie, dont elle a reconnu avant tout le monde l'originalité exceptionnelle dégage de lui-même ce qu'il peut produire de plus haut et de meilleur. «J'ai une avidité de votre perfection», reconnaît-elle; et cette perfection est tout autre chose que «vos succès de salon ou de vogue (ceux-là, je les déplore, ils vous perdent pour l'avenir), c'est votre vraie gloire, votre gloire d'avenir dont je parle; j'y attache autant d'importance que si je portais votre nom ou si je vous approchais d'assez près pour qu'elle rayonnât autour de moi.
Elle s'impose comme un devoir d'être la conscience artistique de cet homme dont elle connaît aussi bien la grandeur et la bonté que le dangereux penchant à se dissiper et à céder par vanité enfantine aux avances mondaines. Et au risque de perdre cette amitié qui est ce qu'elle a de plus précieux dans la vie, elle exprime avec sa merveilleuse franchise ses réserves aussi bien que son approbation, se distinguant sciemment en cela des princesses et des dames de la haute société qui portent aux nues l'écrivain à la mode sans faire aucun choix dans son œuvre. ...]
RETOUR HAUT DE PAGE